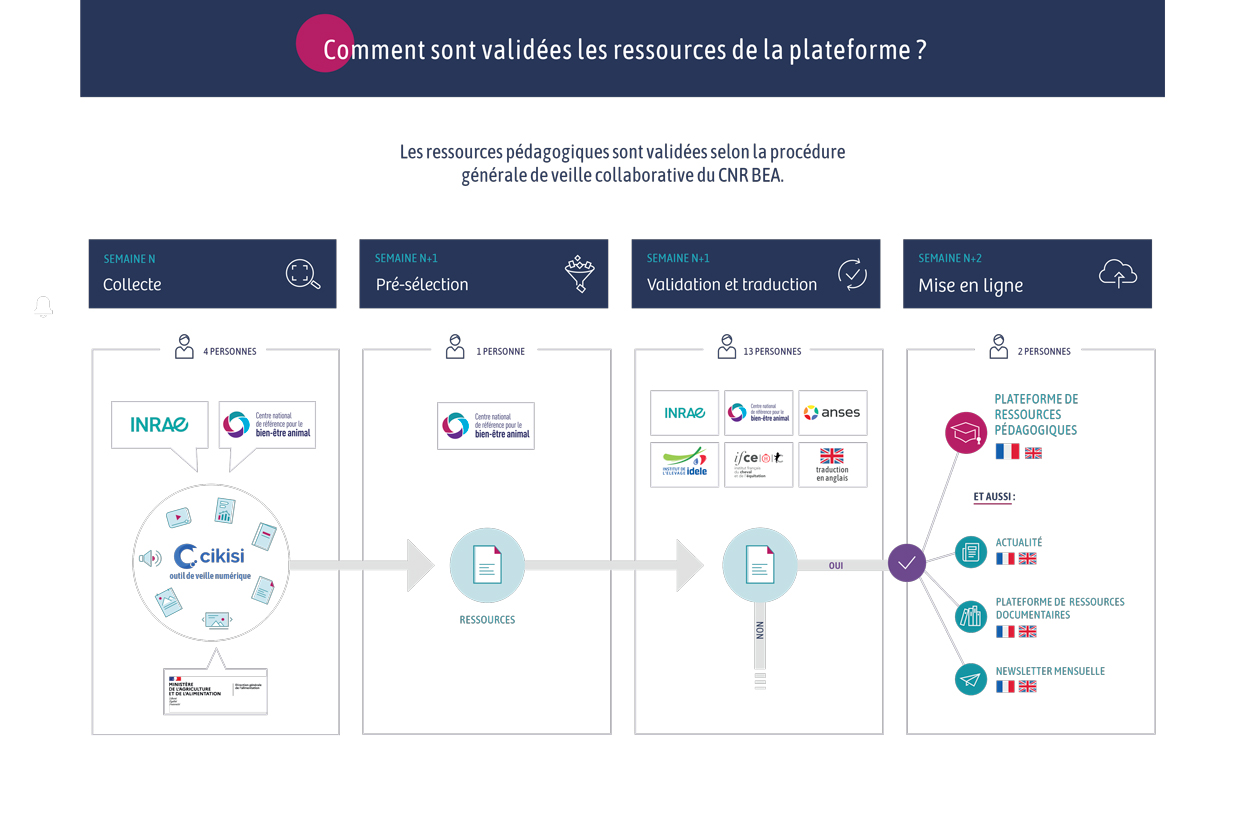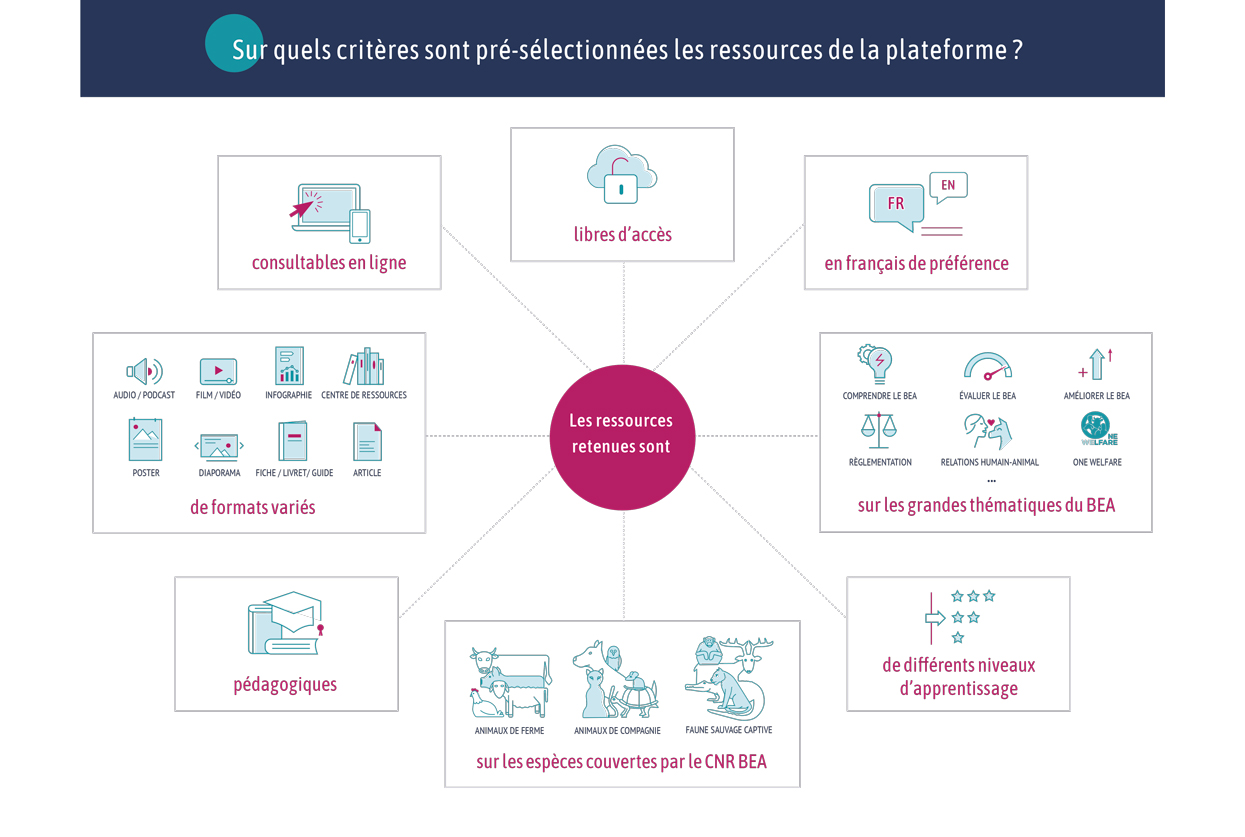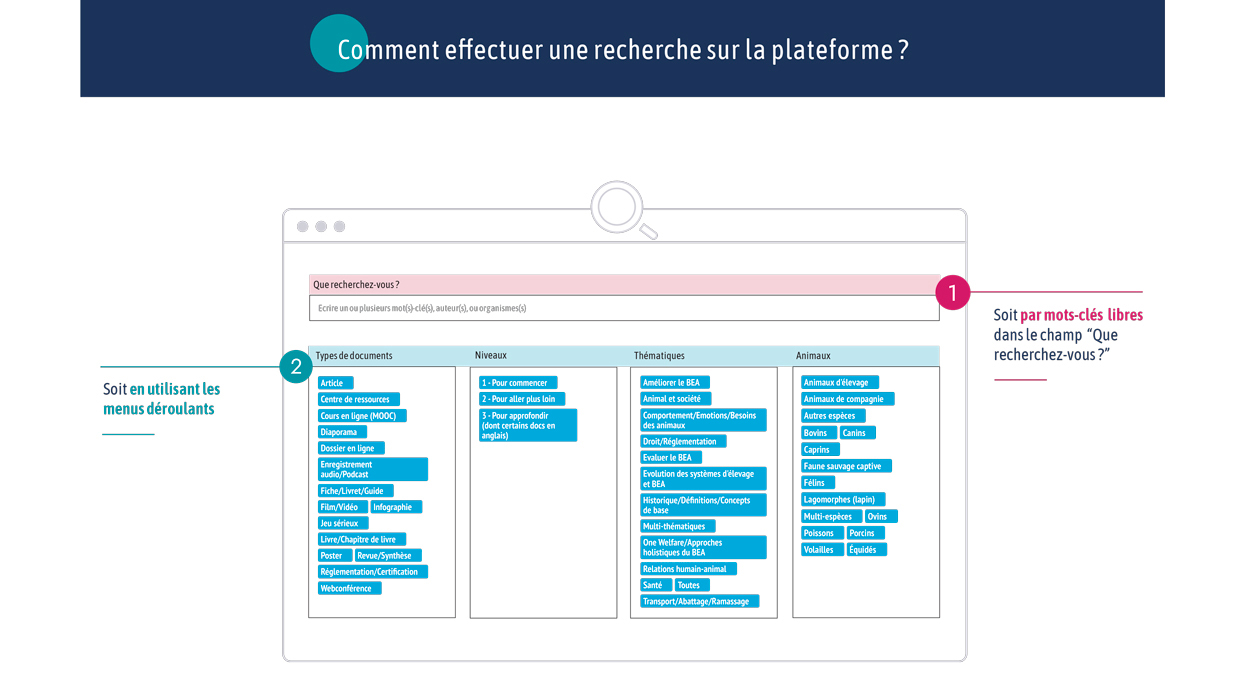Type de document : article publié dans Ouest France – Le Mag des Animaux
Auteure : Nathalie Truche
Extrait : La sensibilité des poissons a longtemps été sous-estimée car ces animaux silencieux sont souvent perçus comme des êtres dénués de conscience et de sensations. Pourtant, des recherches récentes montrent qu’ils peuvent souffrir lors des pêches à l’hameçon ou en filet. Notre article explique le fonctionnement de la douleur et du stress chez les poissons et la manière dont les scientifiques évaluent leur ressenti. En comprenant les mécanismes impliqués dans leur souffrance, il est possible de mieux appréhender leur bien-être et de prendre des mesures adéquates.
Quel est le mécanisme de la douleur ?
La douleur est une réaction biologique permettant à un organisme de détecter et d’éviter les blessures. (…)
Le stress, c’est quoi ? (…)
Les poissons ressentent-ils le stress ?
Les poissons ressentent bien le stress, comme l’ont prouvé de nombreuses études mesurant leur taux de cortisol après une exposition à une situation anxiogène. Lorsque des poissons sont capturés, manipulés ou placés dans un environnement inadapté, leur respiration s’accélère et leur comportement change. Certains deviennent agités, d’autres adoptent un état léthargique, et beaucoup perdent l’appétit. De plus, une exposition prolongée au stress les rend parfois plus vulnérables aux infections et réduit leur espérance de vie.
Comment savoir si un poisson souffre ?
Les scientifiques ont mené plusieurs expérimentations pour déterminer si les poissons souffrent réellement. En voici quelques exemples :
Une expérience marquante a été réalisée par la biologiste Lynne Sneddon, spécialiste de la douleur chez les poissons. Dans cette étude, des truites arc-en-ciel ont reçu une injection de venin d’abeille ou d’acide acétique dans les lèvres, une zone riche en terminaisons nerveuses. Les résultats ont montré que ces poissons manifestaient des comportements anormaux : ils se frottaient frénétiquement la bouche contre le sol ou les parois de leur aquarium, respiraient plus rapidement et refusaient de s’alimenter. Ces réactions suggèrent que les poissons éprouvaient une douleur persistante et cherchaient activement à la soulager. Lorsque ces mêmes poissons ont reçu de la morphine, un analgésique puissant, ils ont retrouvé un comportement normal, ce qui prouve que la douleur ne relevait pas simplement d’un réflexe mais bien d’une sensation consciente. Une autre expérience, menée par le Dr Victoria Braithwaite, a consisté à placer des poissons dans un bassin où ils pouvaient choisir entre un espace neutre et un espace contenant une substance analgésique. Les spécimens ayant subi une blessure ont préféré l’environnement enrichi en analgésiques, suggérant qu’ils sont capables de détecter et de rechercher un soulagement actif de leur douleur, un comportement similaire à celui observé chez les mammifères. D’autres études ont analysé les réactions des poissons à des stimuli douloureux en mesurant leur niveau de cortisol (hormone liée au stress, voir plus haut). Par exemple, lorsque des individus sont pris dans des filets ou manipulés hors de l’eau, leur taux de cortisol augmente significativement, ce qui indique une détresse physiologique en plus d’une éventuelle douleur. Enfin, des recherches en neurobiologie ont démontré la présence de nocicepteurs et des structures cérébrales permettant de traiter la douleur. Leur cerveau, bien que différent de celui des mammifères, contient des régions fonctionnellement similaires, comme le pallium, qui joue un rôle dans la perception sensorielle et les réactions émotionnelles. Des études d’imagerie cérébrale ont confirmé que ces régions s’activent lorsqu’un poisson est exposé à un stimulus nocif.
L’hameçon est-il douloureux pour les poissons ?
Un hameçon transperce des zones particulièrement sensibles de la bouche ou de la gorge du poisson, où se trouvent de nombreux nocicepteurs. En plus de cette blessure physique, l’animal subit un stress intense en luttant pour se libérer et, s’il est sorti de l’eau, il souffre d’asphyxie, un processus comparable à une suffocation chez l’humain. De nombreuses études ont montré que les poissons capturés et relâchés continuent à montrer des signes de stress et de douleur pendant plusieurs heures, ce qui remet en question l’idée selon laquelle la pratique du « no-kill » ne cause pas de souffrance.
La pêche au filet fait-elle souffrir les poissons ?
La pêche industrielle en filet génère également douleur et stress chez les poissons. L’animal piégé dans un espace restreint avec des centaines ou des milliers de congénères, se débat pour fuir, ce qui peut entraîner des blessures graves (écorchures, contusions, voire fractures). Certains spécimens, comme ceux pris dans des filets maillants, restent accrochés par les branchies ou les nageoires et subissent une asphyxie progressive s’ils ne sont pas rapidement remontés à la surface. Dans le cas du chalutage, où un immense filet est traîné derrière un bateau, les poissons sont souvent écrasés sous le poids des autres captifs, ce qui provoque des lésions internes et des hémorragies. Une fois remontées à bord, les prises sont exposées à une différence brutale de pression susceptible de provoquer des barotraumatismes : vessie natatoire éclatée, yeux exorbités et organes internes endommagés. En outre, la plupart des poissons capturés par des filets meurent asphyxiés après avoir été sortis de l’eau puisqu’ incapables de respirer hors de leur milieu naturel. Leur suffocation dure de quelques minutes à plusieurs heures pour les espèces les plus résistantes. Parfois, les poissons vivent encore lorsqu’ils sont éviscérés ou congelés, prolongeant ainsi leur agonie.
Comment éviter la souffrance chez les poissons ?
Quelques solutions ont été identifiées pour limiter la souffrance des poissons : par exemple, les pêcheurs amateurs peuvent se servir d’hameçons sans ardillon afin de réduire les blessures de leurs prises et de limiter le temps de capture pour minimiser le stress. Certaines pêcheries industrielles commencent à tester des méthodes d’abattage plus rapides et moins douloureuses, comme l’électronarcose (qui consiste à étourdir l’animal avec un courant électrique) ou l’exposition immédiate à des eaux glacées saturées en CO₂. Cependant, ces pratiques restent minoritaires et rarement appliquées en haute mer. Une meilleure réglementation de la pêche commerciale et une sensibilisation du public aux conditions de capture permettraient d’améliorer le sort des poissons. Les consommateurs peuvent en effet s’impliquer en privilégiant les produits issus de pêcheries et d’élevages qui s’engagent à respecter le bien-être animal.